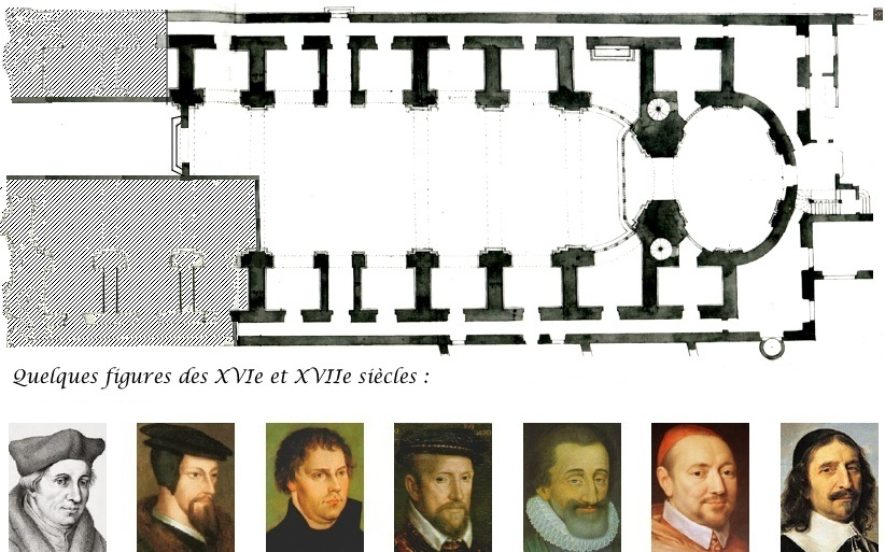Auberge de Cyrano
Premier voisin de l’Oratoire : le pâtissier de Cyrano
Pendant la construction de l’église, le célèbre Ragueneau tenait une auberge à proximité.
Le plus proche voisin de l’Oratoire fut, à ses débuts, le pâtissier-traiteur-rôtisseur Cyprien Ragueneau rendu célèbre, à la fin du XIXᵉ siècle, par l’écrivain marseillais Edmond Rostand qui en fit l’un des protagonistes de son Cyrano de Bergerac. Dans le volume consacré à l’Ile-de-France de L’inventaire du patrimoine culinaire de la France, paru en 1993, les auteurs situent, en effet, l’auberge du pâtissier-poète au 149 rue Saint-Honoré. C’est-à-dire à l’emplacement où se trouve actuellement le Club de gymnastique qui jouxte le temple.
L’ouvrage se réfère également à Gault et Millau pour préciser que l’enseigne de l’établissement portait l’inscription : « Aux amateurs de haulte gresse ». On doit à la vérité d’indiquer qu’Edmond Rostand, lui, situait la fameuse auberge « au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue de l’Arbre-Sec », au carrefour nommé autrefois Croix-du-Trahoir. Une version qui n’est pas nécessairement la bonne, car l’auberge avait disparu depuis plus de deux siècles quand l’écrivain publia Cyrano en 1897.
L’auberge avant l’Oratoire
Quoi qu’il en soit, le jeune Cyprien Ragueneau, qui était né le 8 janvier 1608 à Paris, a assisté à la construction de l’église de l’Oratoire puisqu’à l’époque ses parents tenaient déjà leur restaurant familial dans ce quartier. L’adolescent avait treize ans quand le duc de Montbazon, gouverneur de Paris, posa le 17 septembre 1621, la première pierre de l’édifice qui sera achevé neuf ans plus tard. C’est dire que Cyprien Ragueneau, qui prit la succession de ses parents, était aux fourneaux pendant toute la durée des travaux.
On raconte que le cardinal de Richelieu, qui appréciait ses pâtés de viande et de poisson, fut l’un de ses meilleurs clients. Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, fréquenta lui aussi son établissement, de même qu’un certain Cyrano de Bergerac, un authentique Parisien sans aucun lien avec la Dordogne et auteur de récits de voyages imaginaires, comme Histoire comique des États et Empires de la Lune. Deux siècles et demi plus tard, Edmond Rostand en fera un personnage picaresque de son Cyrano qui sera joué, pour la première fois, au théâtre de la Porte Saint-Martin.
En écrivant cette pièce, qui connut un succès universel, l’Académicien a fait passer à la postérité deux personnages authentiques qui auraient été, sans lui, condamnés à l’anonymat : Savinien de Cyrano (né en 1619, à Paris) d’abord, qui fut un individu ondoyant et assez peu homme de lettres, mais aussi le brave pâtissier Ragueneau, mort dans la misère en 1654 à Lyon après avoir fini moucheur de chandelles dans la troupe de Molière.
Une tradition qui se perpétue
N’ayant laissé aucune trace de ses recettes gourmandes, on aurait sans doute ignoré la plus célèbre d’entre elles, celle des tartelettes amandines, inscrite à l’inventaire des pâtisseries parisiennes, sans l’idée de génie de Rostand. Celui-ci, en effet, a reproduit en vers à l’acte II, scène IV, de Cyrano de Bergerac, la fameuse recette d’une petite tarte ronde de 8 cm de diamètre à base de pâte sucrée, de crème d’amandes et d’amandes effilées, avec une garniture de confiture de fruits rouges.
La tradition de cette tartelette, dont les Parisiens raffolaient au début du XXᵉ siècle, se perpétue dans le quartier de l’Oratoire où il existe au 202 rue Saint-Honoré (près du Palais-Royal) un restaurant-bar-salon de thé-pâtisserie à l’enseigne de Ragueneau. Les murs du rez-de-chaussée sont couverts de photos de diverses représentations de « Cyrano de Bergerac » et la carte est pleine de dénominations sans équivoque : « tartines gourmandes de Ragueneau », « tartes salées de Cyrano », « les salades de Cyprien » et aussi, bien sûr, « les douceurs du pâtissier-poète ».
C’est à ce chapitre que l’on découvre la tartelette amandine en deux versions : aux framboises ou aux pommes. Le dimanche, après le culte, on peut aussi s’en procurer à la boulangerie Gosselin (123-125 rue Saint-Honoré). Dans le quartier de l’Oratoire, cette gourmandise reste une tradition et elle est un peu notre madeleine de Proust.
Triste fin
Raison de plus pour évoquer avec compassion le destin de son créateur qui fut aussi notre voisin. Rostand est dans le vrai quand il décrit Ragueneau comme un excellent pâtissier-rôtisseur qui eut le tort de vouloir taquiner la Muse. Auteur de plusieurs centaines de sonnets, odes, élégies et autres comédies héroïco-comiques de piètre qualité, il se ruina en nourrissant gratuitement une cohorte de poètes faméliques qui le payaient en vers à sa louange. Au grand dam de Lise, son épouse, qui emballait la marchandise dans cette profusion de médiocres écrits.
En 1649, Cyprien Ragueneau mit la clé sous la porte, abandonna l’auberge voisine de l’église de l’Oratoire et rejoignit la troupe de Molière à Béziers où on le vit plus souvent dans la cuisine que sur la scène. Sa fille, en revanche, épousa le comédien Lagrange qui fut le premier administrateur de la Comédie Française.
Roger Pourteau

Tartelette amandine de la boulangerie de la rue Saint-Honoré, 2025.
La recette de la tartelette amandine
Voici, telle que Rostand la fait réciter par Ragueneau dans Cyrano de Bergerac, la recette de la fameuse tartelette, la seule version parvenue jusqu’à nous.
Ragueneau.
Comment on fait les tartelettes amandines.
Battez, pour qu’ils soient mousseux,
Quelques œufs ;
Incorporez à leur mousse
Un jus de cédrat choisi ;
Versez-y
Un bon lait d’amande douce ;
Mettez de la pâte à flan
Dans le flanc
De moules à tartelette ;
D’un doigt preste, abricotez
Les côtés ;
Versez goutte à gouttelette
Votre mousse en ces puits, puis
Que ces puits
Passent au four, et, blondines,
Sortant en gais troupelets,
Ce sont les
Tartelettes amandines !