Le riche mourut aussi
Luc 16:19-31
Culte du 22 novembre 1936
Prédication de Wilfred Monod
Culte à l’Oratoire du Louvre
22 novembre 1936
« Le riche mourut aussi »
Grande collecte pour les pauvres.
« Le pauvre mourut, le riche mourut aussi. »
Luc 16, 22
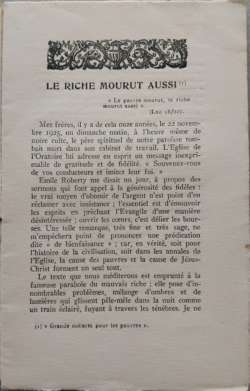
Prédication publiée par Fischbacher, série XV, 4. 1936. Imprimerie A. Coueslant, Cahors.
Mes frères, il y a de cela onze années, le 22 novembre 1925, un dimanche matin, à l'heure même de notre culte, le père spirituel de notre paroisse tombait mort dans son cabinet de travail. L'Église de l'Oratoire lui adresse en esprit un message inexprimable de gratitude et de fidélité. « Souvenez-vous de vos conducteurs et imitez leur foi. »
Émile Roberty me disait un jour, à propos des sermons qui font appel à la générosité des fidèles : le vrai moyen d'obtenir de l'argent n'est point d'en réclamer avec insistance ; l'essentiel est d'émouvoir les esprits en prêchant l'Évangile d'une manière désintéressée ; ouvrir les cœurs, c'est délier les bourses. Une telle remarque, très fine et très sage, ne m'empêchera point de prononcer une prédication dite « de bienfaisance ; car, en vérité, soit pour l'histoire de la civilisation, soit dans les annales de l'Église, la cause des pauvres et la cause de Jésus-Christ forment un seul tout. »
Le texte que nous méditerons est emprunté à la fameuse parabole du mauvais riche ; elle pose d'innombrables problèmes, mélange d'ombres et de lumières qui glissent pêle-mêle dans la nuit comme un train éclairé, fuyant à travers les ténèbres. Je ne tenterai point d'interpréter le récit dans ses détails : qu'il suffise de noter le contraste violent, fantastique : d'un côté, le pauvre, léché par les chiens ; de l'autre, le riche, léché par les flammes ; leur sort est donc toujours inégal, soit ici-bas, soit là-haut. Cependant, il existe un point où les destinées se rencontrent, une charnière autour de laquelle tourne l'ensemble du drame c'est la mort. « Le pauvre mourut, le riche mourut aussi. »
Dans les labyrinthes où s'entrecroisent les nomades processions des humains, un avis — toujours le même — se dresse à tous les carrefours : Par ici la sortie. Et quelle est donc l'unique issue vers laquelle pointe, inlassablement, une flèche aiguë ? — La mort. Vers ce tourniquet final avancent — bon gré, mal gré, — les hommes. Le « condamné à mort » ne l'est pas plus que son juge. Tous ceux qui meurent par la guerre auraient dû mourir, tôt ou tard, par la paix. Le cardinal de Mazarin, parvenu au terme de son existence princière, gémissait devant ses tableaux : « Il va falloir abandonner cela ! » Il se trainait à reculons vers le tombeau ; mais il rencontra, au tournant suprême, des misérables qui se précipitaient vers le suicide, par la même porte de sortie.
De la vieille devise républicaine : Liberté, Égalité, Fraternité, il est un mot, celui du milieu, qui reste voilé durant la vie terrestre ; mais il s'illumine au moment de la mort, et cesse d'être un mensonge ; il subsiste seul, et dans les ténèbres, il flamboie…
« Le pauvre mourut, le riche mourut aussi. »
⁂
Quelqu'un demandera : « Que prétendez-vous tirer de là en faveur des indigents ? Le terrain où vous êtes placé est celui de la nature, de l'univers, de la création (peu importent les termes) — c'est le terrain du fait brutal. Alors osez voir la réalité ; elle éclate ici-bas dans toutes les galeries géologiques ; oui, dans le silence des muséums, la froide raison entend hurler des milliers de hauts-parleurs ; toutes ces formes animales, conservées sous vitrine, crient la tyrannie de la mort fatale à travers l'empire illimité de la vie. Les sanctuaires de la biologie sont les catafalques pompeux érigés sur la « fosse commune » où gisent pêle-mêle, broyées sous les fléaux d'airain de la loi naturelle, toutes les créatures, sans exception, qu'anima le souffle vital.
« Et c'est dans un univers pareil, que vous jouez la flûte niaise de la compassion envers les indigents ? Je déplore leur existence, mais pas plus que celle de notre planète ou de notre Voie lactée. Suis-je responsable du fait que les poissons, par myriades, s'entre-dévorent dans les ténèbres de l'océan, mouvant miroir du soleil splendide ? Est-ce ma faute, s'il existe des Hottentots, des Fuégiens ? D'ailleurs, la religion hindoue enseigne que la caste des parias est d'une autre essence que la caste des brahmanes. En pleine Europe, un État puissant bétonne toute sa politique sur un axiome importé de l'antiquité païenne, opposant le Grec et le Juif, l'Aryen et le Sémite. Dès lors, imprudent sermonneur ! pourquoi tentez-vous de troubler ma conscience morale, en m'apitoyant sur le sort des pauvres ? Ils appartiennent au plan de l'univers, ou, du moins, à la texture même des choses, et je ne suis pas plus responsable des indigents que des vipères ou des comètes. »
Mes frères, ce n'est pas dans un sanctuaire chrétien qu'il faut esquisser une réfutation quelconque d'un pareil système de désespoir. La table sainte, même quand la communion n'est pas célébrée, rayonne toujours aux yeux de la foi, comme un brasier d'enthousiasme et de charité. Sans doute, un certain cynisme apparent peut correspondre aux affreuses désillusions d'une sensibilité blessée, d'une sympathie impuissante ; mais, hélas ! il existe, aussi, une méchanceté froide, un monstrueux égoïsme : devant ces manifestations d'un endurcissement démoniaque, on ne saurait que répéter avec douleur la poignante et généreuse déclaration de l'apôtre : « Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ ; je vous en reparle encore, les larmes aux yeux. »
⁂
Examinons, maintenant, sous un autre aspect, notre texte d'aujourd'hui : « Le pauvre mourut, le riche mourut aussi. » On peut tirer de ces paroles une conclusion diamétralement contraire à celle que nous venons d'écarter. Par exemple, on dira, et avec raison : « Puisque deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles, alors, puisque le pauvre et le riche sont finalement soumis au même sort, il faut en bonne logique les tenir pour des pareils, pour des « semblables », dans toute la vigueur de ce terme expressif, usé par l'accoutumance. Quand le praticien, dans un laboratoire d'anatomie, dissèque le cadavre du riche et le cadavre du pauvre, allongés côte-à-côte sous la pointe fouilleuse du même scalpel, est-ce qu'une même pitié n'étreint pas l'âme du savant devant l'une et l'autre dépouille mortelle, si rigoureusement interchangeables ? Ces corps nus et jumeaux racontent la même histoire, proclament une commune origine, une commune destinée. Qui donc aurait l'idée absurde ou odieuse de palper leurs anciens vêtements, afin de découvrir lequel de ces deux immobiles, de ces deux silencieux, possédait le porte-monnaie le mieux garni ?
Et si l'on trouvait, par hasard, que l'un des deux gisants a expiré les poches vides, sans un sou, tandis que l'autre a succombé nanti d'un carnet de chèques, est-ce que les sentiments du chirurgien seraient modifiés devant les restes mortels de l'indigent ? Loin de là ; sa compassion et son respect seraient, au contraire, intensifiés devant l'injustice du sort, puisque ces deux frères mystérieux, étendus épaule contre épaule, sous le glacial baiser de la mort, ne furent pas traités d'une manière impartiale au cours de leur carrière.
Car, songez-y bien : si la mort égalise, du point de vue « scientifique », le pauvre et le riche, elle ne parvient pas à défaire l'iniquité, l'injustice précédente et prolongée, sur le plan « social ».
Certains moralistes abstraits, certains philosophes spiritualistes, ont parfaitement tort de statuer je ne sais quel faux ajustement, je ne sais quel équilibre erroné entre la destinée du riche et la destinée du pauvre, sous prétexte que le muscle cardiaque, pour l'un comme pour l'autre, cessera brusquement de battre dans la cage thoracique. Oui, les cœurs s'arrêtent peut-être, au même instant, dans la double poitrine ; mais qui donc rétablira des deux parts la coordination, par exemple, entre les circonstances de la maladie, entre les ambiances familiales, entre ces milieux qui se côtoyaient sans jamais s'interpénétrer ? Voici un pauvre qui agonise durant une période atroce de chômage ; il voit pâlir les joues de ses enfants amaigris ; il observe les yeux, rougis par des larmes furtives, d'une femme, sa riante fiancée de jadis, aujourd'hui son héroïque épouse, demain une veuve et une mère privée du nécessaire ; je dis bien : du « nécessaire ». Prétendrez-vous qu'il suffira du choc de la mort physique, après la torture d'une mort préalable sur le plan moral pour établir une balance entre les circonstances du riche et celles du pauvre ? Le parallèle est grossier, insoutenable. Ces essais d'équivalence, d'équation, de parité, choquent trop violemment le réel. Certains efforts d'ajustement artificiel entre des situations durement concrètes et impossibles à coordonner, bien loin d'apaiser le contraste, exaspèrent le scandale.
Dans la ville de Rouen, avant la [Première] guerre mondiale (c'est-à-dire à l'époque où de fades légendes placent le « Paradis perdu » de l'Europe), une de mes paroissiennes disait : « Qu'il est difficile de nourrir six bouches ! — Vous êtes quatre personnes, répondis-je, deux parents, deux enfants. » Elle riposta : « Vous oubliez le propriétaire et le boulanger. Au début de chaque journée, leur part, à eux aussi, est mise de côté ! » Dans la même ville, une femme courageuse me confia qu'un de ses garçons était faible d'esprit : « Et la preuve, affirmait-elle, avec une pathétique précision, c'est que, pendant les repas, il mange à sa faim. »
Alors, mes frères, pour se consoler de pareilles choses, il ne suffit nullement de se réfugier dans la certitude que le pauvre et le riche, après leur mort, sont inscrits à la Mairie, l'un et l'autre, par le même « Bureau des décès ». Il ne suffit même point d'évoquer la grandiose doctrine du salut offert à tous, et la vision grandiose d'un monde futur offert à chacun. Sans doute, la foi totale en une éternité possible de bonheur aide le croyant à supporter sa propre souffrance ici-bas, et la transfigure ; mais ce credo ne garantit pas du pain, des souliers, et des remèdes, à ses enfants ici-bas. Et si, par hypothèse, il pouvait s'en consoler, des millions d'athées fanatisés, exaspérés, maudiraient sa veulerie et agiteraient les rouges bannières où figure l'inscription vengeresse : « La religion est l'opium du peuple. »
Nous voilà donc, mes frères, dans la terrible région des avalanches. Vous savez que, dans la haute montagne, il suffit parfois d'une patte d'oiseau pour déplacer un petit paquet de neige, un peu de poussière blanche ; celle-ci commence à glisser le long des pentes, elle s'agglomère et forme balle, elle grossit, elle bondit, entraîne des rocs, arrache des arbres, détruit des chalets, elle finit par ensevelir un village. Ainsi en est-il, à certaines époques, des souffrances et des rancœurs accumulées par de séculaires iniquités. Tout à coup d'énormes déplacements d'idées se produisent ; des passions, longtemps immobiles en de lointaines brumes, se ruent soudain en avant ; elles deviennent tourbillon, tonnerre ! Si elles contiennent d'effroyables colères, elles renferment aussi des indignations légitimes : cet amour sacré de la justice fraternelle qui inspirait les prophètes israélites et qui palpita dans les Béatitudes évangéliques... Une patte d'oiseau peut déclencher une avalanche ! Ainsi la colombe du Saint-Esprit renversa l'Empire des Césars ; et elle détruira dans l'avenir toute civilisation hypocrite, faussement chrétienne, fondée sur le sable des égoïsmes rivaux et des intérêts antagonistes, au lieu d'être bâtie sur le roc de la Loi divine. « Aime Dieu, aime ton prochain », les deux commandements n'en forment qu'un seul.
En résumé, les simples mots de la parabole « Le pauvre mourut, le riche mourut aussi », suffiraient, peut-être, à encourager deux attitudes qui se contredisent ; d'un côté, argumentent les fatalistes qui prennent leur parti de la misère — (celle du prochain), — pour des motifs tirés de l'histoire naturelle ; de l'autre côté se dressent les protestataires, exaspérés contre le régime social du paupérisme ; non point pour leur avantage particulier, mais par solidarité fraternelle. De même que l'opinion publique en France, et les chefs de notre magistrature, commencent à dénoncer avec véhémence le système pénitencier des travaux forcés à la Guyane, de même un nombre croissant d'âmes généreuses, dans le monde entier, s'élèvent contre la perpétuité d'un ordre social qui maintient des millions et des millions de créatures humaines dans ce bagne infernal qu'on nomme la pauvreté ; par celle-ci j'entends, très simplement, tout cruellement, cet état de choses où la sécurité du lendemain n'est jamais assurée, où la requête centrale de l'oraison dominicale : « Père donne-nous notre pain quotidien ! », apparaît de nos jours encore, pour des millions et des millions de nos semblables — (pesez ce terme : nos semblables) — comme un vœu fantastique, digne des chimères des Mille et une nuits.
Telles sont, en gros, les deux écoles qui pourraient s'appuyer sur notre texte : d'une part, il y a les déterministes, résignés à ce qui existe, — et pas un de nous n'accepte un pareil programme de déchéance et de désespoir ; d'autre part, il y a les croyants, les espérants, ceux qui, lorsqu'ils s'écrient : « Notre Père ! » font un acte de foi solennel en la famille universelle des frères ; or tous, oui vraiment, tous, dans la présente assemblée, malgré des formules différentes, vous aspirez d'une manière plus ou moins consciente, mais avec une loyale ou sainte ferveur, à l'exaucement de l'idéal évangélique dans le domaine social : la fin du chacun pour soi, la fin de la lutte hideuse et atroce de tous contre tous.
⁂
Assurément, le but n'est pas encore atteint ; il faut planter des jalons, construire les routes qui s'orientent vers la Cité future, imiter le cantonnier sublime, Jean le Baptiste, « qui aplanissait les voies du Seigneur ».
Toutefois, en attendant les vastes réalisations entrevues, il nous faut courir au plus pressé, aujourd'hui même — vaquer aux tâches prochaines, répondre aux appels urgents. Telle sera ma conclusion pratique.
Il n'est pas superflu de la formuler, car des gens excellents, férus de logique, paraissent dédaigner l'exercice de la naïve et sincère compassion envers les individus, pris un à un. D'après eux, on ne résoudra point le problème social en s'occupant des isolés. Voilà une remarque très juste, mais stérile. Nous savons parfaitement, car nous avons tous lu saint Paul, que l'aumône reste inférieure à la charité ; mais pourquoi la charité, elle, ne pourrait-elle pas s'épanouir en aumône ? Refuserions-nous de tendre l'éponge de vinaigre à un crucifié, sous prétexte que seul un régime coopératif du travail, dans le domaine social, mettra fin à un système de civilisation où se dressent côte à côte les trois lugubres croix de la concurrence anarchique, de la surproduction industrielle, et du chômage en masse ?
Combien nous avons besoin encore de la bienfaisance officielle, et même de la charité privée ! Eh quoi ! il faudrait suspendre l'écriteau Relâche au-dessus de notre précieuse « Délégation générale des Diaconats », qui distribue le pain, les vêtements, les remèdes, les secours de loyer ; qui assure la pension des orphelins, l'hospitalisation des infirmes et des vieillards, qui envoie les enfants à la campagne, et les protège, ces petits, victimes des grands, contre le rachitisme et la tuberculose ?
Ô François d'Assise ! ô Vincent de Paul ! ô John Bost ! vous qui avez serré sur votre cœur les pauvres de Jésus-Christ, vous étiez donc dans l'erreur. Le fondateur — qu'il soit béni ! — de l'Institution de nos Diaconesses françaises, a divagué en les appelant : « Sœurs de charité protestantes » ? Ah ! qu'on nous laisse la joie grave, indicible, de l'amour qui pleure avec ceux qui pleurent !
Allons-nous effacer de l'Évangile cette page merveilleuse où il est raconté que Jésus, dans le temple de Jérusalem, debout près du tronc où l'on déposait les offrandes, admira la veuve pauvre qui donna plus que tous les autres, car elle avait pris sur son humble nécessaire ? Et la parabole du bon Samaritain ? Et la parabole du Jugement dernier ? Ces rayons, ces fusées, ces éclairs, étouffés par l'éteignoir !
Oh ! sous les chocs effroyables de la brutalité sans nom qui enserre et martèle aujourd'hui le monde, ne sentez-vous pas que le moindre frisson de pitié, le moindre élan de compassion cachée, est un credo magnifique, un acte de foi en Dieu, une protestation hardie, sacrée, contre le règne de l'Adversaire et le triomphe menaçant, ici-bas, de la Bête apocalyptique ! L'autre jour, à l'heure du crépuscule, je fus convoqué à une réunion intime de pasteurs, qui désiraient préparer ensemble une retraite spirituelle. Pendant que je m'y rendais, j'entendis une fillette inconnue qui interrogeait sa grand'mère, en passant devant la caserne coloniale [Lourcine, 37 boulevard du Port-Royal] ; aux grilles du « quartier », les indigents se pressaient pour une distribution de soupe ; et la petite voulait connaître la raison d'un moutonnement de dos courbés. L'aïeule répondit placidement : « Ce sont des indigents tout à fait, qui n'ont pas d'intérieur. Il reste de la nourriture des soldats ; pour ne pas la perdre, on la donne aux malheureux. » Un peu plus tard, après ma rencontre mystique avec des serviteurs de Dieu, j'aperçus, dans un couloir du métropolitain, un misérable qui mendiait, appuyé à la muraille, et courbé en avant ; sa tête pendait sur sa poitrine. Quand je lui parlai, il me confia qu'il était malade, et sans domicile fixe : autrement, fiévreux et affamé il aurait cherché refuge à l'hôpital… Ô mes frères ! c'est à dessein que je raconte ces deux anecdotes banales, quasi-insignifiantes, puisqu'elles n'émeuvent guère votre imagination, et touchent à peine peut-être notre cœur. Mais quand j'y réfléchis, quand je songe que dans la Ville de Paris, l'un des points les plus glorieux de notre planète, l'un des centres les plus anciens et les plus éclatants de la civilisation occidentale, j'ai dû insérer une réunion religieuse entre les mâchoires infernales de ces deux faits sans témoins, inaperçus des policiers et des journalistes, je demeure accablé. Si je me laissais aller à la sourde angoisse de la réalité, les paroles me resteraient à la gorge. Et d’ailleurs, en face du spectre innommable de la Pauvreté, tout discours, même religieux, même un sermon de bienfaisance et de charité, sonne creux : c'est de l'insupportable rhétorique. Et puis, le prédicateur est envahi par un sentiment amer, et qui l'empoisonne, d'hypocrisie…
Alors je m'arrête. Le silence devient le plus digne témoignage au Fils de l'homme qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête.
« Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ; et ce que vous n'avez pas fait… »
Pardonne, Seigneur, ô pardonne !
« Seigneur ! tu sais toutes choses, tu sais pourtant que je t'aime. »
Amen.
NOTE
La parabole est difficile à interpréter. Voici le passage auquel est emprunté le texte : « Il arriva que le pauvre mourut, et qu'il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. » La mort est, chaque fois, un phénomène identique sur le plan corporel : mais ce qui la suit est différent. Ici les questions se pressent. En effet, il n'est pas enseigné que le riche fut, à proprement parler, châtié ; on dirait qu'il souffre en vertu de l'adage populaire : « Chacun son tour ». Lazare fut abreuvé de maux ici-bas ; il sera heureux plus tard ; l'autre, comblé de biens, sera malheureux dans l'au-delà ; le sablier est retourné.
Alors une injustice nouvelle semble créée ! Car la vie terrestre de Lazare était courte, et la vie posthume du riche sera illimitée. Encore s'il s'agissait d'un « Purgatoire », qui améliore le coupable ! Mais celui-ci (à l'envisager comme tel) a beau se convertir à la pitié, intercéder pour ses frères, cette compassion ajoute à sa douleur morale, sans diminuer sa torture physique.
Bref, la première partie de la parabole ne parlait pas de châtiment ; et dans la seconde, il s'agit de terribles peines correctionnelles. La tradition aurait ainsi développé la parabole dans le sens d'une allégorie : le riche serait devenu le judaïsme, ennemi de l'Évangile ; tandis qu'on aurait identifié Lazare avec l’Église, tourmentée par la Synagogue. (Voir le commentaire de Johannès Weiss).
Pour aller plus loin
- Présentation et liste des prédications en ligne de Wilfred Monod (lire)
- Frise chronologique : 1825 : œuvres caritatives protestantes
- Livret commémoratif en 1932 : Cinquantenaire de la Délégation générale des diaconats (CASP)
Lecture de la Bible
Évangile selon Luc 16, 19-31
19Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. 20Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, 21et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche ; et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. 22Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 23Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 24Il s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement dans cette flamme. 25Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 26D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. 27Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père ; 28car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. 29Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent. 30Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. 31Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait.